Nos devoirs envers la Nature
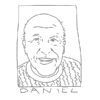
Un texte de Daniel Laguitton
Paru dans le numéro Hiver/Winter 2025-26
Publié le : 11 novembre 2025
Dernière mise à jour : 17 novembre 2025
Tout droit est associé à une règle morale ou sociale régissant les rapports des membres d’une même société et — on l’oublie trop souvent — implique des devoirs.
Dans un monde où une ploutocratie nostalgique des monarchies absolues profite de la perte de repères généralisée pour instaurer des régimes autoritaires, un petit tour d’horizon de la notion de « droit » n’est certainement pas un luxe. Tout droit est associé à une règle morale ou sociale régissant les rapports des membres d’une même société et — on l’oublie trop souvent — implique des devoirs.
Dès les premières lignes de L’Enracinement : prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain, Simone Weil (1909-1943) affirme que « La notion d’obligation prime celle de droit, qui lui est subordonnée et relative. Un droit n’est pas efficace par lui-même, mais seulement par l’obligation à laquelle il correspond ; l’accomplissement effectif d’un droit provient non pas de celui qui le possède, mais des autres hommes qui se reconnaissent obligés à quelque chose envers lui ».
Un siècle avant l’auteure de La pesanteur et la grâce, Chateaubriand (1768-1848) écrivait dans Mémoires d’outre-tombe : « […] il y a une loi morale qui règle la société, une légitimité générale qui domine la légitimité particulière. Cette grande loi et cette grande légitimité sont la jouissance des droits naturels de l’homme, réglés par les devoirs ; car c’est le devoir qui crée le droit, et non le droit qui crée le devoir ; les passions et les vices vous relèguent dans la classe des esclaves ».
Pour Simone Weil, « Cela n’a pas de sens de dire que les hommes ont, d’une part des droits, d’autre part des devoirs. Ces mots n’expriment que des différences de point de vue. […] Un homme, considéré en lui-même, a seulement des devoirs, parmi lesquels se trouvent certains devoirs envers lui-même. Les autres, considérés de son point de vue, ont seulement des droits. Il a des droits à son tour quand il est considéré du point de vue des autres, qui se reconnaissent des obligations envers lui. Un homme qui serait seul dans l’univers n’aurait aucun droit, mais il aurait des obligations ».
Les impératifs écologiques n’étant généralement pas reconnus par sa génération, Simone Weil considérait que « L’objet de l’obligation, dans le domaine des choses humaines, est toujours l’être humain comme tel. Il y a obligation envers tout être humain, du seul fait qu’il est un être humain ». Pour elle, cette obligation, qu’elle qualifiait d’éternelle et d’inconditionnée, est « reconnue par tous dans tous les cas particuliers où elle n’est pas combattue par les intérêts ou les passions. C’est relativement à elle qu’on mesure le progrès ».
Déjà sévère, comme on l’a vu plus haut, au sujet du rôle des passions dans la dynamique des droits et des obligations, Chateaubriand l’est plus encore à propos du rôle corrupteur des intérêts lorsqu’il écrit : « Le ministère a inventé une morale nouvelle, la morale des intérêts ; celle des devoirs est abandonnée aux imbéciles. Or, cette morale des intérêts, dont on veut faire la base de notre gouvernement, a plus corrompu le peuple dans l’espace de trois années que la révolution dans un quart de siècle. Ce qui fait périr la morale chez les nations, et avec la morale les nations elles-mêmes, ce n’est pas la violence, mais la séduction ; et par séduction j’entends ce que toute fausse doctrine a de flatteur et de spécieux ». Non attribués, ces mots pourraient passer pour une tirade contre la démagogie populiste des ploutocrates qui poussent aujourd’hui comme des champignons vénéneux partout sur la planète. Le célèbre écrivain malouin renchérit même : « Le genre humain en vacances se promène dans la rue, débarrassé de ses pédagogues, rentré pour un moment dans l’état de nature, et ne recommençant à sentir la nécessité du frein social que lorsqu’il porte le joug des nouveaux tyrans enfantés par la licence ».
L’image du « genre humain en vacances » sied particulièrement bien aux sociétés « économiquement prospères » où le tumulte des intérêts et des passions fait si souvent oublier les devoirs inséparables de tout droit, en particulier les devoirs envers la Nature. La résistance à reconnaître ces droits honorés de tout temps dans les sociétés autochtones est encore très forte chez l’Homo industrialis, même si ses conséquences catastrophiques sont évidentes.
Un changement a été amorcé, en 1972, par la publication d’un article intitulé Les arbres devraient-ils avoir une personnalité juridique ? Vers la reconnaissance de droits pour les entités naturelles. Son auteur, Christopher Stone, professeur de droit à l’Université de Californie du Sud y écrit : « Je propose tout à fait sérieusement que nous reconnaissions légalement des droits aux forêts, aux océans, aux rivières et aux autres entités dites “naturelles” de notre environnement, en fait, à toute la nature qui nous entoure ».
En dépit des critiques qui suivirent, la notion de « droits de la Nature » était entrée dans la conscience collective et de nombreuses démarches visant à légaliser ces droits ont ensuite pris forme dans plusieurs pays. Depuis 2006, en Nouvelle-Zélande, le fleuve Whanganui, a le statut légal d’entité vivante et ses droits peuvent être défendus devant les tribunaux. En 2017, inspirée par l’exemple néo-zélandais, la Haute Cour de l’État de l’Uttarakhand, dans le nord de l’Inde, reconnaissait une personnalité juridique à deux rivières. Les initiatives de ce type se sont multipliées depuis, y compris au Québec où, en 2021, l’Alliance pour la protection de la rivière Magpie [Muteshekau Shipu, en langue innue], en partenariat avec l’Observatoire international des droits de la Nature (OIDN), reconnaissait la personnalité juridique et les droits de cette majestueuse rivière de la Côte-Nord.
« On peut juger de la grandeur d’une nation par la façon dont elle traite les animaux », affirmait Gandhi. Dans le sillage de cette formule, des efforts sont déployés depuis plusieurs décennies pour reconnaître les droits des animaux. L’éminente primatologue Jane Goodall (1934-2025) a consacré sa vie à la défense de ces droits et a changé à jamais notre regard sur le monde animal. Dans son ultime message à l’humanité, elle déclarait : « Ne perdez pas espoir. […] Si vous voulez sauver ce qu’il reste de beauté dans ce monde […] pour vos petits-enfants et leurs petits-enfants, réfléchissez à la manière dont vous agissez chaque jour ».
Daniel Laguitton, Abercorn

